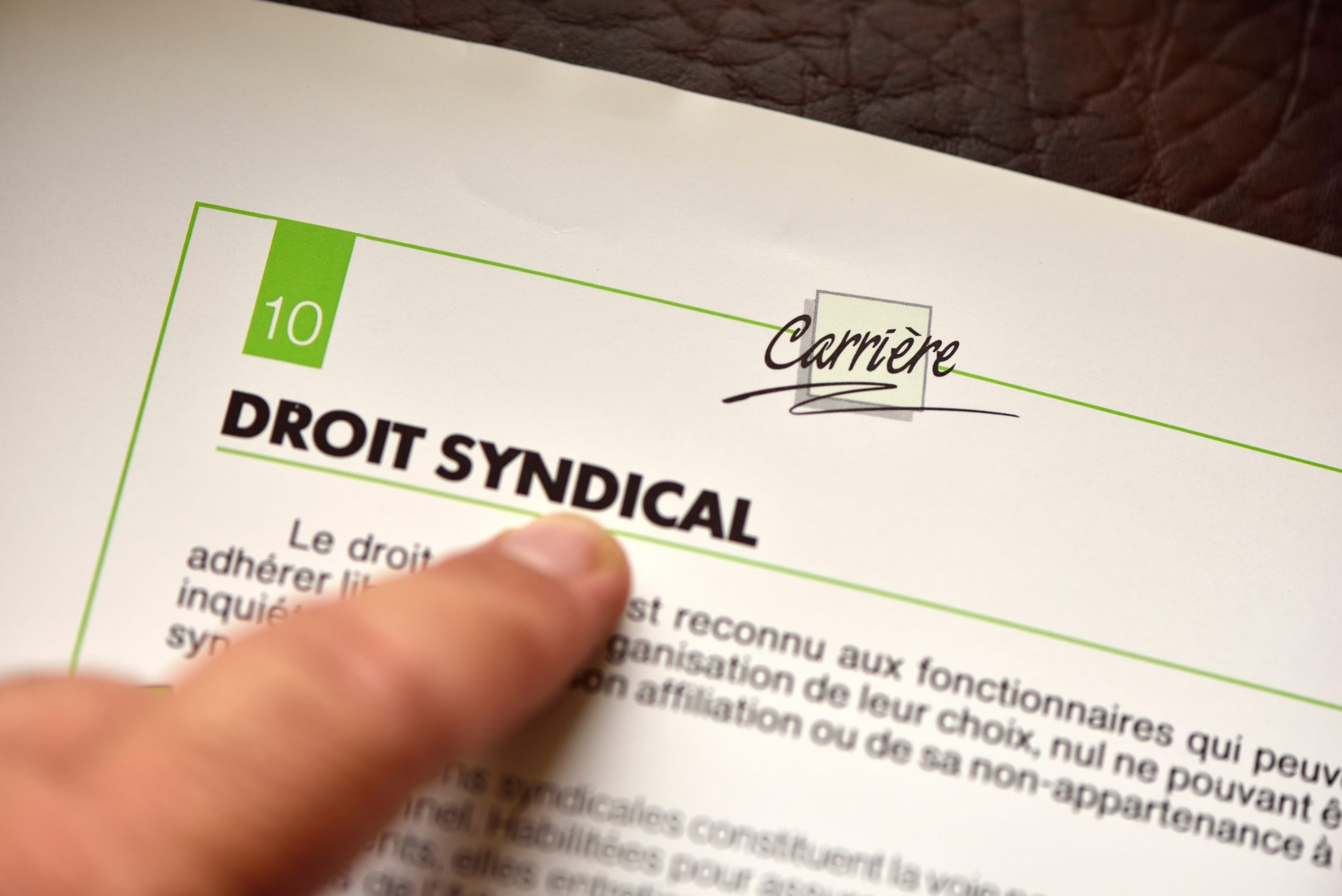Chaque année, le Global Rights Index publié par la Confédération Syndicale Internationale (CSI) dresse l’état des lieux des droits syndicaux dans le monde. En 2025, le constat est particulièrement préoccupant. Non seulement les atteintes aux libertés syndicales s’intensifient à l’échelle mondiale, mais des pays considérés comme stables et démocratiques, dont la France, connaissent des régressions importantes. Alors que l’on vante souvent le « modèle social français », le rapport met en lumière une réalité bien plus contrastée – voire alarmante.
Le Global Rights Index 2025 évalue 151 pays à partir de près d’une centaine d’indicateurs liés à la liberté syndicale, au droit de grève, à la négociation collective et à la protection contre les discriminations. Chaque pays reçoit une note de 1 (la meilleure note) à 5, les plus mauvais scores signalant une destruction pure et simple de l’état de droit en matière de relations de travail. Ce classement repose sur des sources juridiques, des témoignages syndicaux, des données issues de l’Organisation Internationale du Travail et des enquêtes de terrain. Et cette année, les conclusions sont sans appel : les droits des travailleurs sont fragilisés partout, sans exception. Ils ne sont plus que sept pays, parmi lesquels l’Allemagne, la Suède et la Norvège, à décrocher la note maximale cette année – contre dix-huit il y a dix ans (la France n’en a jamais fait partie) . Une chute significative qui illustre l’érosion progressive des garanties syndicales, même dans les démocraties les plus stables.
Plus de 87 % des pays étudiés violent le droit de grève, 74 % empêchent la formation ou l’enregistrement de syndicats, 73 % restreignent l’accès à la justice pour les travailleurs (un record). Le climat de répression ne se limite pas aux pays les plus autoritaires : l’Europe, les Etats-Unis, et même l’Australie ont vu leurs scores se détériorer. La liberté d’expression et de réunion est désormais limitée dans près de la moitié des pays étudiés. Le droit au syndicalisme, autrefois perçu comme une conquête démocratique fondamentale, devient une cible dans un monde de plus en plus soumis à l’autoritarisme, à la financiarisation de l’économie, et à l’affaiblissement volontaire des contre-pouvoirs sociaux.
La France n’échappe pas à la spirale du recul social
Dans ce contexte global, la France obtient une note de 2, une classification qui place le pays dans la catégorie des États où les violations répétées des droits syndicaux sont constatées, aux côtés de nations comme l’Australie, l’Italie, la Pologne, les Pays‑Bas, la Suisse, le Japon, ou encore des pays d’Amérique latine tels que le Mexique et le Paraguay. À première vue, ce score peut sembler rassurant, surtout comparé à des pays où l’état de droit a été entièrement démantelé. Mais ce serait oublier que la France représente depuis des décennies un modèle social avancé, porté par une tradition de luttes syndicales puissantes. Or, ce même modèle est aujourd’hui sérieusement mis en cause.
Les auteurs du rapport relèvent une série de dysfonctionnements inquiétants en France. Le droit de grève, bien que reconnu dans la Constitution, fait l’objet de restrictions croissantes, notamment dans les services publics où les préavis, les réquisitions et les dispositifs de « service minimum » vident la grève de sa substance. Dans le secteur privé, les militants syndicaux sont fréquemment exposés à des pratiques antisyndicales : pressions, mises à l’écart, harcèlement, voire licenciements abusifs. À cela s’ajoutent les réformes successives du droit du travail, qui ont affaibli le rôle des représentants du personnel en concentrant le pouvoir décisionnel dans les mains des directions. La CSI pointe également les obstacles rencontrés par les travailleurs pour accéder à la justice, en particulier les délais excessifs devant les tribunaux et les plafonds encadrant les indemnisations en cas de licenciement abusif, qu’elle considère comme autant de freins à une réparation équitable.
Pire encore, les mobilisations syndicales sont désormais confrontées à une réponse policière disproportionnée en France. Le rapport souligne que l’usage de la force lors des manifestations, les gardes à vue préventives ou les dispositifs de surveillance pèsent sur la capacité à s’organiser collectivement. En particulier, il indique que « plus de 1 000 dirigeants syndicaux et membres de la CGT ont fait l’objet de poursuites au pénal et de mesures disciplinaires pour le rôle qu’ils ont joué dans les manifestations de masse contre la réforme des retraites ». Ces pratiques, qui contredisent l’image d’une France garante des libertés publiques, participent d’un climat où la contestation sociale est de plus en plus perçue comme une menace à neutraliser, plutôt qu’un droit à protéger.