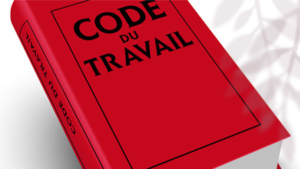Introduite en 2014 (L. nᵒ 2014-344 du 17 mars 2014), l’action de groupe a été étendue au droit du travail en 2016 mais les organisations syndicales représentatives ne pouvaient agir que dans un cadre limité à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles (L. nᵒ 2016-1547 du 18 nov. 2016).
Depuis la loi du 30 avril 2025, entrée en vigueur le 3 mai 2025, l’action de groupe peut désormais être intentée par les syndicats représentatifs pour faire cesser tous les manquements de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles et/ou en demander la réparation.
Actions en justice « traditionnelles » des syndicats
Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats sont recevables à agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
À cet égard, les syndicats, qu’ils soient ou non signataires, peuvent demander sur le fondement de cet article, « l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession » (Cass. soc., 11 juin 2013, nᵒ 12-12818) et « demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte » (Cass. soc., 22 nov. 2023, nᵒ 22-14807).
Par ailleurs, il est constant que les syndicats sont recevables à demander sur le même fondement, l’exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, son inapplication causant nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 14 juin 1984, nᵒ 82-14385).
En revanche, les syndicats ne sont pas recevables à demander la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés ou la réparation des préjudices subis par ces derniers du fait d’un manquement de l’employeur. Ces demandes relèvent de l’intérêt individuel de chaque salarié (Cass. soc., 22 nov. 2023, nᵒ 22-14807). Il a été ainsi récemment rappelé par la Cour de cassation que l’action du syndicat tendant à régulariser la situation individuelle des salariés en télétravail privés de titres-restaurant est irrecevable (Cass. soc., 4 juin 2025, nᵒ 23-21051).
Ces régularisations et/ou réparations individuelles supposent donc l’exercice d’une action en justice par chacun des salariés concernés, étant précisé que l’action du syndicat ne suspend pas la prescription s’agissant des droits individuels (Cass. soc., 6 nov. 2024, nᵒ 23-16632).
Rappelons toutefois que les organisations syndicales sont recevables à agir en justice pour faire valoir les droits d’un salarié déterminé devant le conseil de prud’hommes. Ces actions dites en substitution sont cependant limitées à des domaines particuliers : droits résultant d’une convention ou d’un accord collectif (art. L. 2262-9 CT), travailleurs intérimaires (art. L. 1251-59 CT), harcèlement sexuel ou moral (art. L. 1154-2 CT), licenciement pour motif économique (art. L. 1235-8 CT), etc.
Action de groupe des syndicats
La toute récente réforme de l’action de groupe est susceptible de pallier les limites précédemment rappelées à l’action du syndicat.
En effet, l’action de groupe en droit du travail permet aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement, dans l’entreprise, dans la branche ou au niveau national de demander en justice la cessation d’un manquement d’un employeur mais également, le cas échéant, la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur, autrement dit les salariés et plus largement les travailleurs (art. 16 I C Loi nᵒ 2025-391 du 30 avril 2025).
Les syndicats représentatifs sont donc recevables à demander non seulement la reconnaissance d’un manquement et sa cessation, mais la réparation des préjudices subis par les salariés du fait de ce manquement. Par conséquent, les salariés n’ont plus à former une action en parallèle devant le conseil de prud’hommes pour obtenir la régularisation de leur situation individuelle par l’employeur.
L’exercice de l’action de groupe permet en outre de suspendre la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge (art. 16 IX Loi nᵒ 2025-391 du 30 avril 2025).
Toutefois, cette action de groupe ne peut être exercée que pour les manquements de l’employeur « à ses obligations légales ou contractuelles » (art. 16 I A Loi nᵒ 2025-391 du 30 avril 2025). Il n’est donc pas certain que la violation des dispositions issues d’une convention collective relève du champ d’application de l’action de groupe, quand bien même la notion d’obligations légales ou contractuelles pourrait être entendue très largement.
En outre, la loi dispose que : « Avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au Code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué » (art. 16 I F Loi nᵒ 2025-391 du 30 avril 2025).
Dans le mois suivant cette demande, l’employeur doit en informer le CSE et, s’il en existe, les organisations syndicales représentatives, qui peuvent alors demander qu’une discussion soit engagée sur les mesures susceptibles de faire cesser la situation de manquement alléguée.
Le tribunal compétent ne pourra être saisi d’une action de groupe qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande formulée auprès de l’employeur ou, à compter du rejet de cette demande par l’employeur s’il intervient avant l’expiration de ce délai.
Enfin, l’action de groupe initiée par un syndicat devra être formée devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. La liste des tribunaux compétents a été précisée par décret du 16 juillet 2025 (art. 16 VI, art. L. 211-15 COJ, décret nᵒ 2025-653).
LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes