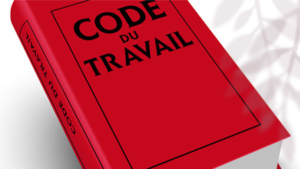La Cour de cassation reconnait, pour la première fois à notre connaissance, le caractère nécessaire et donc automatique du préjudice subi par un salarié victime de discrimination syndicale.
Le principe de la preuve du préjudice subi par le salarié
Pour obtenir réparation en cas de manquement de l’employeur à ses obligations légales ou conventionnelles, le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293). Par exception, la jurisprudence a pu admettre que certains manquements de l’employeur causent nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à réparation automatique. Tel est le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse : la perte injustifiée d’emploi cause un préjudice « nécessaire » au salarié dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Cass. soc., 13 septembre 2017, n°16-13578).
En l’espèce, le licenciement d’un représentant du personnel, déclaré inapte, a été refusé par l’inspecteur du travail qui a estimé que l’inaptitude résultait d’un harcèlement moral. Après expiration de la protection liée à son mandat, le salarié a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes et demandé des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral.
Les juges du fond ont reconnu l’existence d’un harcèlement moral mais ont rejeté sa demande de dommages et intérêts, estimant qu’il n’apportait aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La reconnaissance du préjudice nécessaire en cas de discrimination syndicale
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et donne raison au salarié. Elle affirme que « le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation ».
Pour fonder sa décision, la Haute juridiction s’appuie sur le caractère d’ordre public des dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail qui interdisent à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale dans ses décisions, et qui prévoient que toute mesure contraire est abusive et ouvre droit à dommages et intérêts.
En conclusion, dès lors que la réalité d’une discrimination syndicale est établie, le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation. Le droit à indemnisation est automatique et il appartient aux juges du fond d’en apprécier le montant.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-21124